King Crimson - Lizard
Sorti le: 03/12/2019
Par Jean-Philippe Haas
Label: Island Records / Atlantic Records
Site: https://www.dgmlive.com
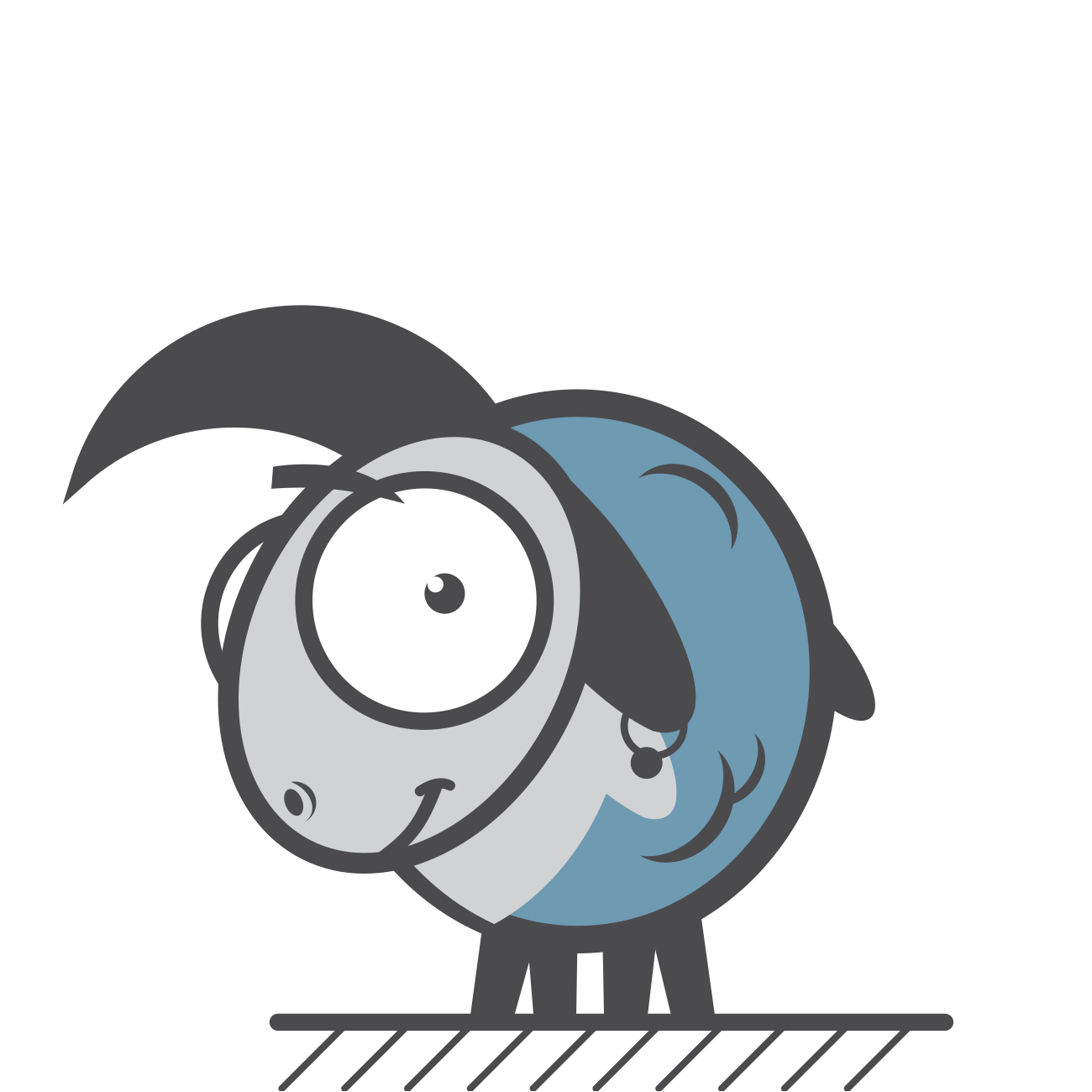
Comment envisager sereinement la suite d’une carrière quand on l’a débutée par un coup de maître un an plus tôt, qu’entre-temps plusieurs de ses musiciens ont déserté et que la tournée censée suivre un second album tiède est annulée ? Le binôme Robert Fripp-Peter Sinfield, soudé par l’adversité plutôt que par des convergences artistiques, n’a qu’une option s’il ne veut pas voir la fragile entité King Crimson voler en éclat : composer un nouveau disque, qui ne sera ni comme In The Court of The Crimson King ni comme In The Wake of Poseidon.
Et en effet, Lizard s’éloigne considérablement des deux albums précédents, par la volonté de s’affranchir encore plus complètement des frontières entre les chapelles musicales que cela n’a été fait jusque là. La rupture est graphique, pour commencer : le nom du groupe s’affiche en grand sur la pochette, sous forme de lettres enluminées façon « Moyen-âge » apportant une aide à la compréhension des textes pas toujours limpides de Sinfield. Pour autant, ce n’est pas la surprise d’emblée car « Cirkus », dénonçant les travers de la société du spectacle, ne joue pas le dépaysement. Ce titre d’ouverture représente une certaine idée de King Crimson, celle d’In The Court… dans son équilibre parfait entre expérimentations et accessibilité. Si Gordon Haskell, déjà entendu sur le précédent album (« Cadence And Cascade ») n’est pas Greg Lake, loin s’en faut, il remplit son rôle (de bassiste chanteur) avec conviction et suffisamment d’emphase, tout comme Andy McCulloch, qui fait peu ou prou du Michael Giles. Les multiples couches des parties instrumentales sont un régal où s’insèrent tour à tour différents claviers (plus variés qu’à l’accoutumée), une guitare acoustique, une guitare électrique (Fripp s’en donne à cœur joie) et le saxophone de Mel Collins.
Plus léger, « Indoor Games » représente le versant pop du groupe, bien que ce terme, appliqué à King Crimson, ne revêt pas le sens qu’on lui attribue habituellement ; on peut s’en apercevoir sur la section centrale, qui laisse libre cours à quelques improvisations. Dans le même esprit, « Happy Family » – allusion à la séparation récente des Beatles qu’on retrouve sur la pochette dans le « i » de Crimson – dispose d’une structure assez similaire ; l’utilisation d’effets vocaux, et là encore d’une certaine dose d’improvisation lorsque tout ce beau monde se met à jouer dans son coin, laisse l’impression d’une cacophonie savamment organisée où tout le monde retombe finalement sur ses pieds. Deux exercices de style, donc, loin d’être inintéressants mais tellement en-deçà des ambitions que peut décemment avoir une telle formation. La première face s’achève sur une note bucolique, à la Genesis, avec le très délicat « Lady of The Dancing Water » qui confirme que ce style de chansons n’est pas le domaine de prédilection de Gordon Haskell.
Est-ce pour donner plus de contenance aux parties chantées que Jon Anderson a été engagé sur « Lizard », mastodonte de plus de vingt-trois minutes qui occupe toute la seconde face ? Quoi qu’il en soit, l’ouverture interprétée par le vocaliste de Yes est majestueuse et suit une progression mélodique imparable calée sur un boléro. L’arrivée d’instruments classiques et du piano de Keith Tipett se fait de la manière la plus naturelle qui soit (peut-être grâce aux accointances que possède le prog avec la musique classique?), contrairement à la partie jazz qui suit, amenée de façon quelque peu artificielle par le trombone et un piano qui change son fusil d’épaule. Mais soit, on se laisse facilement convaincre par ce collage jusqu’au climax de mi-parcours. Passée son introduction, la deuxième moitié retombe assez largement dans l’exercice de style où de savantes broderies instrumentales enrobent des thèmes répétitifs, où de semi-improvisations côtoient des passages dépouillés voire atmosphériques, où on s’essaie à diverses expérimentations sonores. Rien de neuf sous le soleil, donc, ici, malgré une exécution talentueuse.
Fripp et Sinfield ont sans doute été un poil trop ambitieux dans leur désir de mêler rock, jazz et classique, de produire le titre « ultime ». Malgré des efforts certains pour y parvenir, on reste sur notre faim ; « Lizard » ressemble par moments à ce que le prog est destiné à devenir quelques années plus tard : un genre enfoncé dans un pompiérisme un peu vain. Il est vrai qu’en matière de cliché du prog rock, cette « suite conceptuelle » ne parvient que très ponctuellement à se hisser à la hauteur de réussites complètes à venir chez la concurrence : « Close To The Edge » de Yes, le « Supper’s Ready » de Genesis , ou même « Tarkus » d’ELP.
Lizard, à l’image de son morceau-titre, est un album décousu, alternant le faste et l’ordinaire. A sa sortie, l’accueil est mitigé et Fripp n’a alors d’autre choix que de redresser rapidement la barre, ce qu’il fera avec Islands. Dans la mauvaise foi qui le caractérise parfois, il reniera régulièrement son œuvre, même si, plus ou moins contraint et forcé suite au remixage réalisé par Steven Wilson, il lui reconnaîtra finalement des qualités.