Purson - Desire’s Magic Theatre
Sorti le: 11/05/2016
Par Florent Canepa
Label: Spinefarm Records
Site: http://www.purson.co.uk/
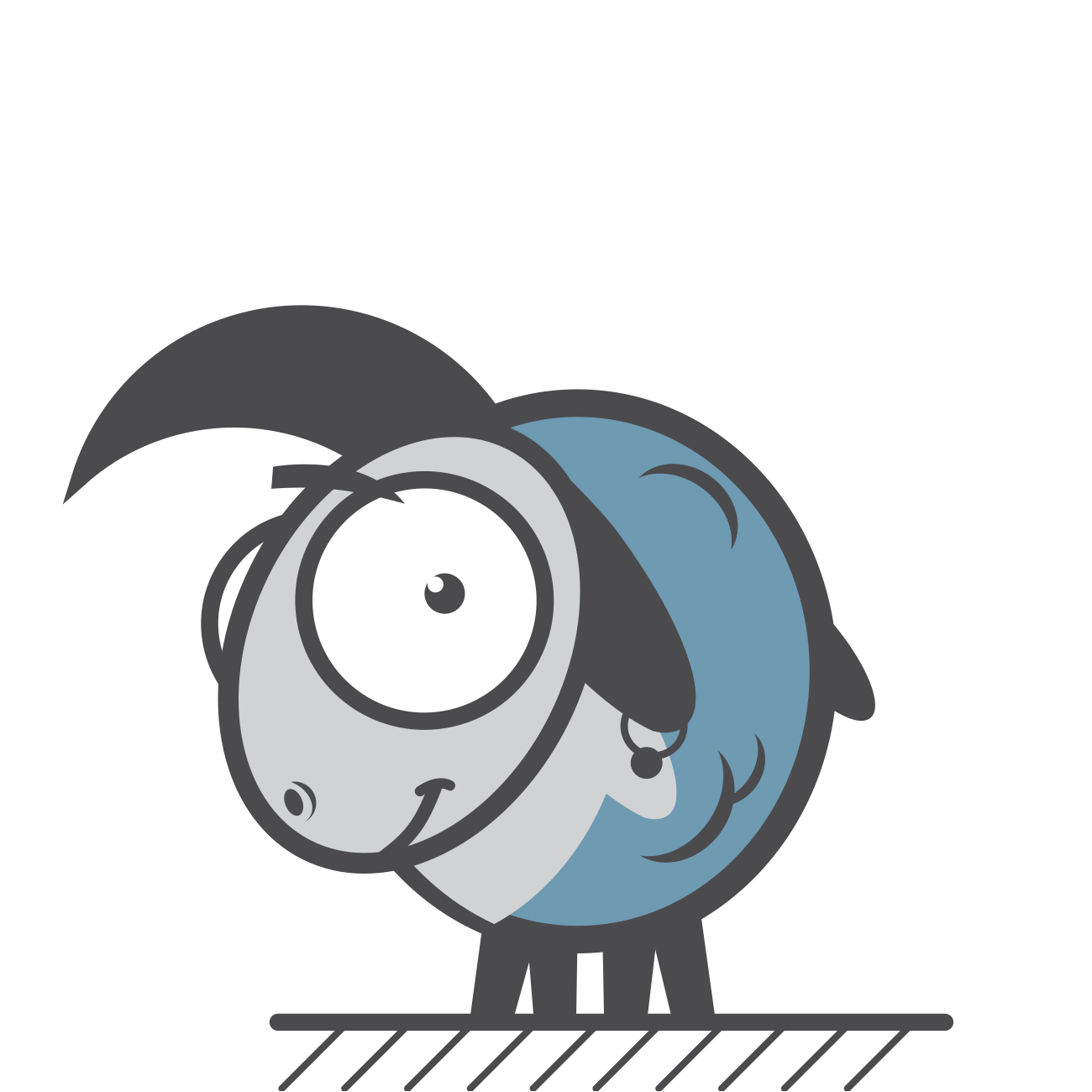
Sur le papier et pour les oreilles, Purson est clairement un exercice de style. Transporter l’auditeur consentant a priori dans l’univers psyché-groovy de la fin des années soixante peut être autant une bénédiction qu’une resucée qui sonne faux. Avec Desire’s Magic Theatre, l’intention de créer un anachronisme est délibérée. On la retrouve aussi bien dans le graphisme, le nom et l’esprit des titres (« Electric landlady », cela vous rappelle quelque chose ?) que dans les arabesques instrumentales. Purson n’a pas peur du cliché et, quelque part, c’est ce qui rend les Anglais téméraires à plus d’un titre. La voix de Rosalie Cunningham colle totalement à l’univers, sorte de rencontre probable entre Cherie Currie sage et Grace Slick vitaminée.
Beatlesien dès le premier titre (au sens Revolver bien sûr), le groupe truffe ses ondes d’orgues fantômatiques, de clavecins sablonneux, de fuzz et, comme attendu, sue le rock psyché par tous les pores. Sa vertu est sans doute de ne pas s’arrêter là et de finalement piocher partout. Quelques cuivres bien sentis mais déjà vus (« Pedigree chums » presque « Soul shadows » des Crusaders). Des cantates du désert à la sauce route 66 en écho aux Doors et Moody Blues sur « The Sky Parade ». « The Bitter Suite » ressuscitant les génériques d’Amicalement vôtre ou James Bond lorsque Shirley officiait plutôt qu’Adèle. On retrouve même en fin de volute (enfin me direz-vous ?) quelques flûtes névrotiques. Là où les radios s’égosillent de stoner, chacun essayant d’être un héritier de Kyuss ou même Black Sabbath à sa façon, Purson remonte son credo temporel encore un peu plus en amont et écrit le LSD des années 2000, avec comme idoles, en vrac, Burroughs, Kerouac, Cream et Iron Butterfly. Remuez le tout, mettez dans un grand saladier.
La plus grande force est malheureusement aussi la plus grande faille. Tout l’album s’écoute avec plaisir, en tapant du pied (« Mr Howard », enrichi de guitares fulminantes) et tout sourire à l’écoute des circonvolutions du genre. Ça sent bon le sillon. Mais qu’en reste-t-il vraiment ? Un fumet fugace de « c’était mieux avant » ? Une envie farouche de poser quelques vinyles inspirants sur sa platine Technics, rangée à la cave par erreur ou par oubli ? Se dire que les Beatles ont tout inventé ? L’objet-album entraîne un détour du regard, annihile presque sa propre identité malgré des efforts plus que louables et une vraie force intrinsèque. Un hommage, comme un mirage.